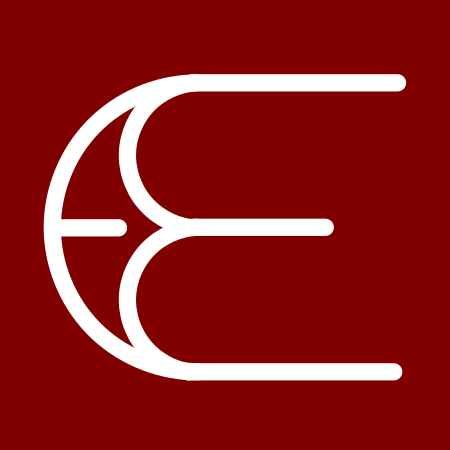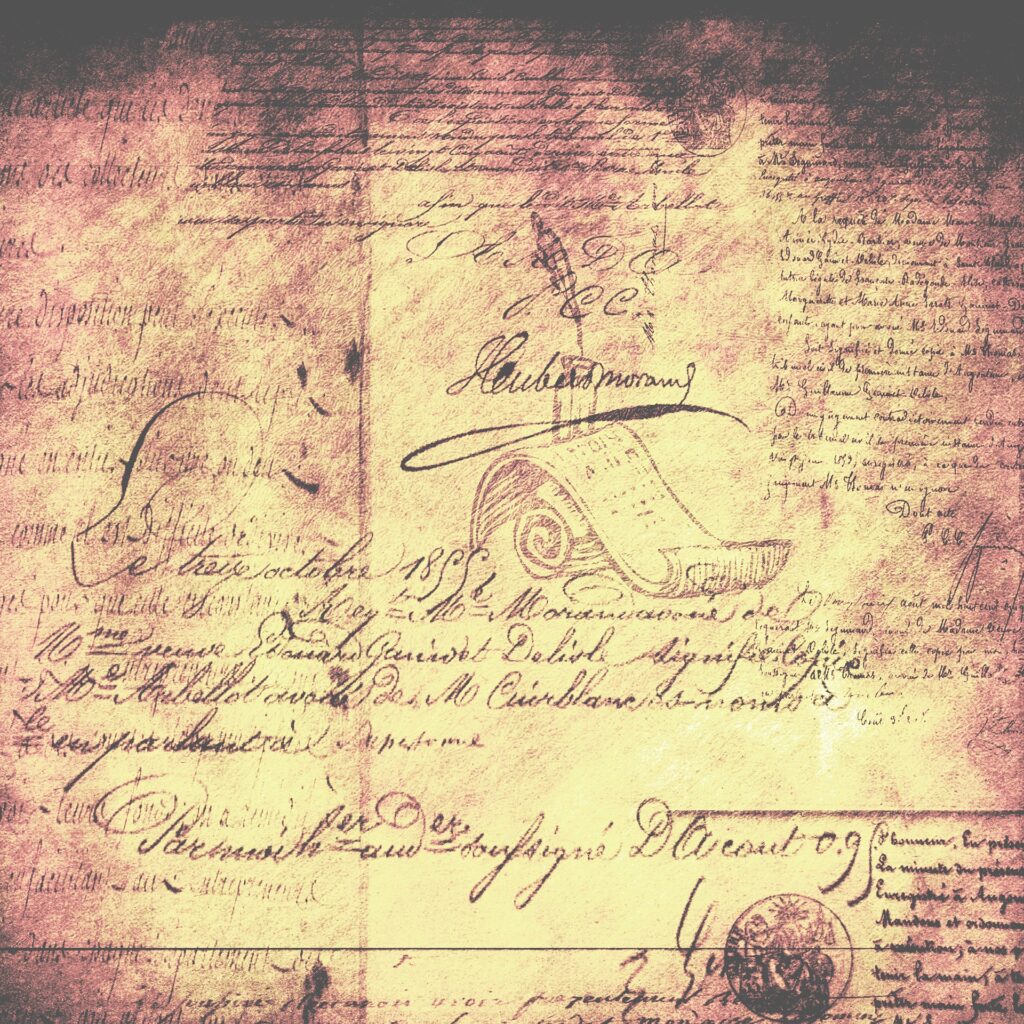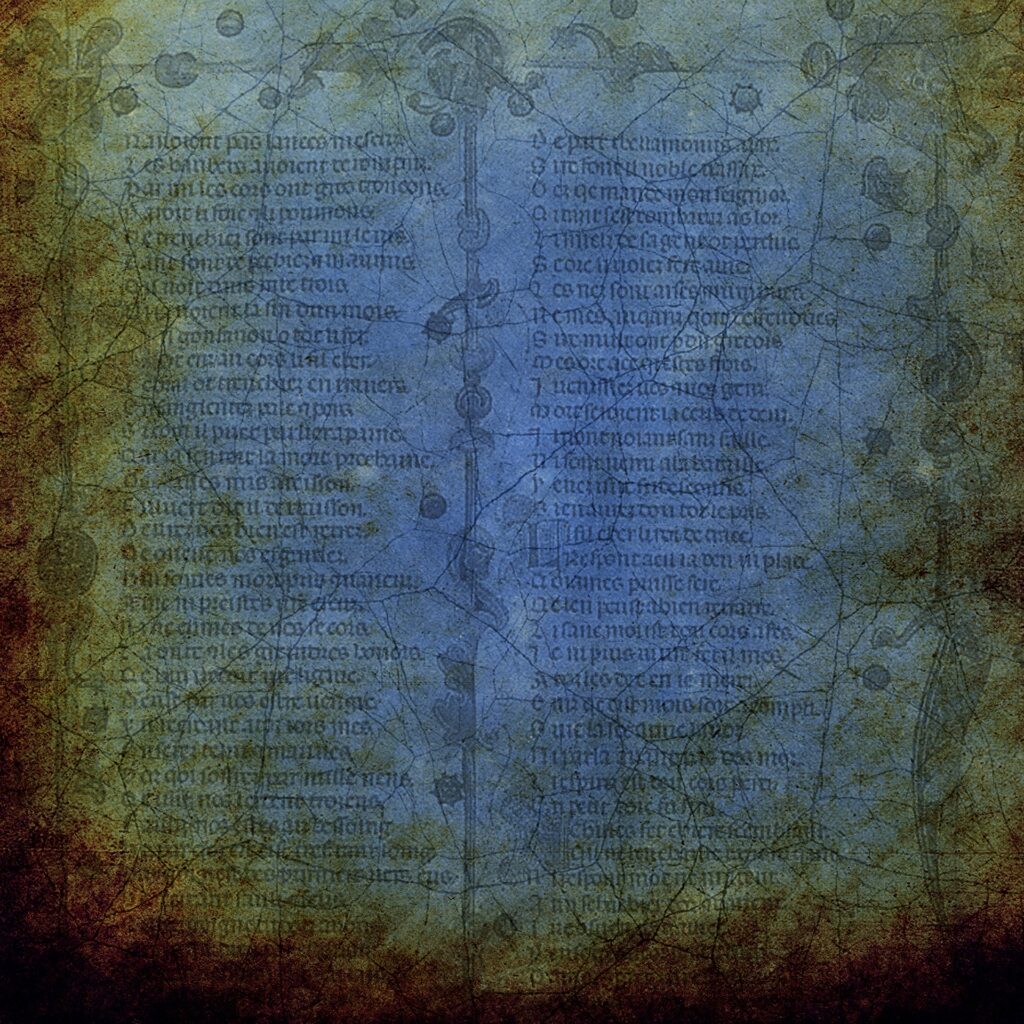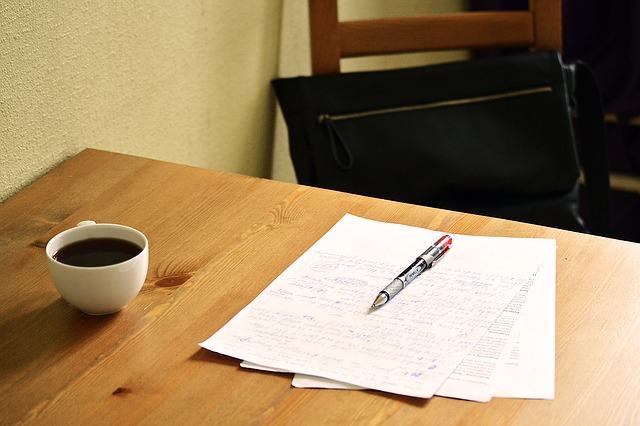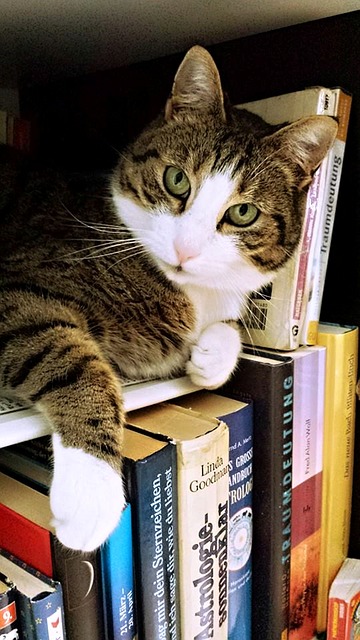Appel à textes, cinquième sélection, “Un ours à reculons” par Elise Vandel-Deschaseaux
Nous voilà arrivés à notre dernière découverte avec notre cinquième sélection pour l’appel à textes « expérimentation libre avec la nouvelle ». Voici “Un ours à reculons” par Elise Vandel-Deschaseaux. En premier lieu, voici les contraintes qui ont pour originalité de se centrer plus sur le côté, relecture/réécriture. Les contraintes : Écrire une « nouvelle instant symbolique ›› qui explore un souvenir en glissant d’un univers à un autre. Qui ait une chute Et comporte une tonalité poétique Défis d’expérimentation : Réviser une nouvelle existante 1) en la réduisant à un nombre de caractères inférieurs (6311 au lieu des 19076 existants), 2) en supprimant les adjectifs inutiles et/ ou précieux, 3) en écrivant au présent, 4) en recentrant le texte sur le ressenti de la narratrice, en plongeant dans sa mémoire. Bonne lecture ! Un ours à reculons Maman me raconte une scène récurrente qui est restée gravée dans ma mémoire de fillette. Son sens du détail me caresse comme une poussière de joie. Les histoires qu’elle me lit ouvrent et referment des parenthèses entre lesquelles se glisse l’orée des rêves. Une de ces histoires me revient pourtant en mémoire avec plus de force que d’autres. A mi-chemin entre le sommeil et le rêve, un paysage maritime tapisse mes paupières : une falaise que survolent les cormorans et les mouettes. Sous ma paupière, le marchand de sable sème la matière grumeleuse qui m’endort. Maman est une rambarde de sécurité contre la voisine ronchon, les bicyclettes à contre-sens et des griffes du chat. Pourtant, insensiblement, jour après jour, les effets apaisants du baume s’atténuent. Ce que papa et maman disent sonne creux. Être la spectatrice unique de leurs mots et gestes m’accable. Qui d’eux ou de moi tisse des mensonges ? Je contourne la question parce qu’il faut bien faire avec la réalité, mais je distends le lien qui nous unit. Papa trouve que le Brandy fait une compagne merveilleuse, toujours d’accord, disponible et à la bonne température. A troquer son remontant contre sa femme, papa perd l’une au profit de l’autre. Il vit un éboulement dans tout son corps humidifié par l’alcool qui dessèche. Sans surprise, papa entame une lente décrépitude, sournoise et diffuse, qui obéit à une géométrie imparable. Papa conserve son esprit clair. Cette lucidité le mène à la déréliction face à laquelle nous redoublions d’inefficacité. Empêtrée dans mes jupes et dans mes jeux, je fonce droit vers ma survie. Maman s’habille d’une peau d’amour pour tout encaisser. Et nous picorons les miettes du bonheur enfoui : les cookies à la noisette, les fous rires devant le miroir, les promenades en forêt. Papa est tenu à distance, comme un étranger. Nous créons un fantôme qui vit sous notre toit mais n’appartient pas à la famille. Il semble tenir bon, mais c’est précisément dans cet intervalle protecteur qu’il est réduit à un point minuscule. Maman étrangle son chagrin dans la mécanique inutile du foyer qu’elle gère avec une hystérie panique : ménage, courses, cuisine, lessives, factures- et recommencer. Mon père a des habitudes qui brossent à grands traits la toile de fond de sa vie, que je qualifie de misérable par souci d’exactitude. J’ai autant besoin de mon père qu’un perroquet de la banquise. Le sas de sécurité entre papa et moi ne se fissure pas avec le temps. Pour attirer son attention, je l’affuble en vain de sobriquets qui ont autant d’effet qu’une larme sur un feu de broussaille. Assise sous les roses trémières, je compte les fourmis. Les soirs où il a bu toute sa paie, Papa siffle ses bouteilles à la maison. Seul. Caché. « – Je vais bricoler dans l’atelier ››, lance-t-il. L’été 1998 passe ainsi. Maman m’emmène pour la dernière semaine d’août chez sa sœur et ses nièces, mes trois adorables cousines. C’est une drôle de semaine, qui me voit coincée entre le besoin de lire le mot septembre sur mon agenda et le tourbillon de vie que forment mes cousines. Les vacances touchent à leur fin. Nous regagnons la maison. Maman ne tourne pas la clé dans la serrure, la porte d`entrée entrebâillée s’ouvre sur Papa, endormi sur le sofa. Nous allons dormir sans le déranger. Au matin, à peine réveillée par les balbutiements du soleil entre les stores, ma gorge se noue brutalement. J’entends les pompiers au rez-de-chaussée. Je sursaute en voyant maman debout près de moi. Elle m’embrasse dans un sanglot fané. Samedi 29 août 1998, veille de nouvelle Lune, une poignée d’heures avant ma rentrée au collège, papa est mort. Qu’aurait pu espérer un homme honnête, taciturne, dont le Brandy est devenu le meilleur ami ? Vient le temps des obsèques, puis celui du recueillement. Après l’incinération, papa semble bien proportionné au fond de sa petite boite, comme s’il recouvrait enfin la consistance éthérée de sa bouteille de whisky. Maman ouvre la boite. Le petit tas couleur de neige sale dégage une odeur transparente. Maman tend le bras en direction de l’à pic et disperse la poudre d’argent dans le vent. Papa constelle la mer d’une couche d’éternité. Le trajet jusqu’à la maison est beau et délassant. L’autoradio émet : « Non, je ne regrette rien » Au début de l’automne, le deuil nous étreint violemment maman et moi. Il ne s’agit pas de faire table rase du passé mais de renaître à la vie qui affleure en surface. Désormais, grand-père vit avec nous. Petit homme rabougri, Isaac a gardé des jambes d’agriculteur robuste qui tiennent bon malgré les années. La vue de mon père aux prises avec l’alcool lui a toujours été insupportable. Alors, il ne nous rendait pas visite. Depuis son mariage, maman y allait seule chaque année. Le départ précipité de papa a fait entrer ce petit homme bossu dans ma vie. Isaac emménage dans l’ancien bureau de papa, et nous sommes de parfaits inconnus l’un pour l’autre. Il range ses affaires bien pliées dans la commode de sa nouvelle chambre. Ce meuble bas, au nom désuet, me plait doublement. L’avantage