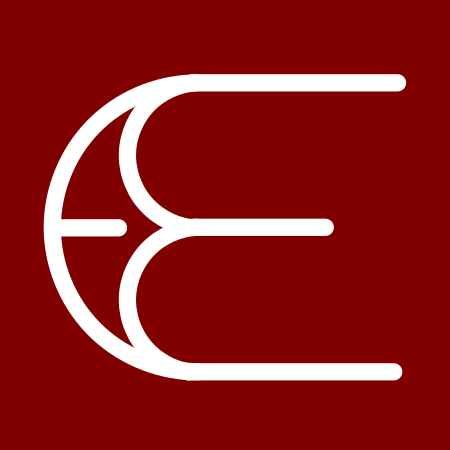Améliorer son texte : travailler le rythme de son récit
Le rythme de son récit : une question primordiale. Personne n’accroche à un texte mal rythmé : il nous ennuie et on l’oublie. Travailler le rythme de son récit, c’est donc se demander comment retenir son lecteur, comment organiser et dire son histoire. Il y a deux façons de travailler le rythme : dans la construction du texte dans le style. Aujourd’hui, voici quelques pistes de construction qui peuvent servir dans n’importe quel texte narratif : romans, nouvelles, novella ou même témoignage et récits de vie. Le rythme et la question du temps dans le récit Le rythme, c’est une question de temps. Or, il faut bien prendre en compte que dans tout texte, il y a deux temps : celui de la chose racontée (l’histoire) et celui mis à la raconter (le récit). Construire le rythme d’un texte, c’est donc créer un jeu entre ces deux temps pour intéresser le lecteur. Scènes, résumés, pauses, ellipses : Pour jouer avec les temps, il faut savoir alterner entre l’écriture de scènes, de résumés, de pauses et d’ellipses. La scène est un texte où le temps du récit est le même que le temps de l’histoire, par exemple dans les dialogues. On a alors l’illusion de vivre l’action dans les personnages. C’est une partie fondamentale du texte, mais il ne faut pas en abuser, au risque de se perdre dans les détails. Il y a ensuite les résumés qui condensent une partie de l’histoire en quelques mots. Au delà de l’effet d’accélération (suspens, tension), cela permet d’avancer dans le texte. Reste à faire attention au style. Sinon, le lecteur aura l’impression qu’on bâcle par paresse ou manque de savoir-faire. A l’inverse, on peut jouer sur les pauses c’est-à-dire des passages où l’histoire n’avance pas : les descriptions, commentaires, digressions… Et pas question de les couper par principe ! Jouer avec le rythme, c’est aussi alterner les moments de tension et de pause, mélanger le contexte, la réflexion et l’action. Enfin, il y a des ellipses, des événements passés sous silence. Parfois elles sont invisibles (toutes ces actions de la vie quotidienne qui ne servent à rien) et donc ultra-nécessaires ! En d’autres occasions, elles créent un effet particulier : de temps perdu, de nostalgie ou encore de mystère. Pensons à tous ces romans policiers qui racontent le crime mais sautent l’avant et l’après pour qu’on ne sache ni les causes ni ce que devient (au début) le criminel. La fréquence de narration : Deuxième élément de la gestion temporelle du rythme : c’est le nombre de fois pour raconter quelque chose. Car oui, il est tout à fait possible de dire plusieurs fois une même chose, tout dépend de ce que vous en découvrez à chaque occurrence ! Ainsi on peut raconter une seule fois un seul événement (c’est le plus classique et le moins risqué). On eut aussi répéter par exemple depuis plusieurs points de vue. C’est plus compliqué mais les effets sont très intéressants en particulier si les différents personnages n’interprètent pas l’action de la même manière. On peut aussi faire l’inverse, raconter en une fois ce qui s’est passé en plusieurs fois, pour faire sentir l’habitude, la routine, l’ennuie… Là encore, c’est l’effet à produire chez le lecteur qui devra guider votre choix. En pratique : comment améliorer le rythme de son récit ? Choisir Tout dépend de ce que vous voulez raconter et de l’effet à produire chez le lecteur. Voulez-vous créer de l’émotion ou de l’angoisse, raconter une vie ou une aventure, explorer une vision du monde, un problème de société, ou donner vie à un lieu ? Demandez-vous aussi qu’elle est la meilleure façon de transmettre cette idée à votre lecteur. Est-ce en accumulant les actions ou en prenant le temps de montrer le passage du temps ? Vérifier Quand vous vous relisez, vérifiez que tout ce que vous avez écrit est nécessaire. Sinon, voyez comment vous pouvez l’enlever. Faites confiance à votre lecteur, il préférera combler les trous (tant qu’il n’y en a pas trop) plutôt qu’avoir l’impression d’être pris pour un idiot. En résumé, la question du rythme est avant tout une question de choix : quoi dire et par quelle technique ? Se préparer La dernière question qui se pose est comment choisir et être sûr de ses choix. A mon avis, il n’y a qu’une seule solution : lire, lire et lire. Lire en cherchant dans les textes que l’aime comment l’auteur fait pour maintenir notre intérêt. Et aussi reprendre les textes qui nous ont ennuyés pour comprendre ce qui a raté et ne pas le reproduire. Ensuite, et bien, il reste à tester, essayer et éventuellement modifier, voir innover ! Dites-vous bien qu’aucun auteur n’y est arrivé du premier coup. Alors, bonne écriture, et bonnes expérimentations !
Améliorer son texte : travailler le rythme de son récit Lire la suite »