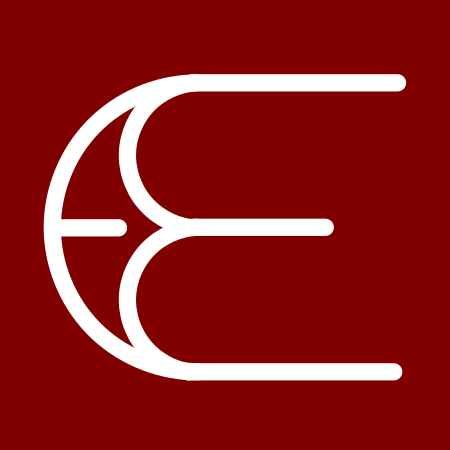Ecrire avec Jane Austen : Du fond de mon cœur, lettres à ses nièces.
Vous n’avez jamais rêvé de recevoir les conseils de votre auteur préféré ? Avec Jane Austen, c’est presque possible. Je m’explique. Jane Austen avait plusieurs nièces qui écrivaient et lui envoyaient leurs textes. Bien que de nombreuses lettres aient été détruites, certaines ont été préservées et récemment traduites. Grace à elles, voici les grandes lignes de l’art d’écrire selon Jane Austen. Un credo de Jane Austen : la liberté de l’auteur Jane Austen le répète, c’est l’auteur qui a le dernier mot, et toutes ses critiques sont faites de façon à ne pas blesser. Elle argumente et justifie ses remarques, plaide pour l’humour et le plaisir d’écriture. Enfin, elle refuse de se plier aux modes et surtout elle encourage « Je t’en prie, continue ! ». Un exemple à suivre pour bien des animateurs et bêta-lecteurs ! Approfondissement et refus des clichés. Que ce soit au niveau de la construction de l’histoire, des personnages ou du style, Jane Austen rappelle l’importance d’aller au bout des choses, sans accepter la paresse du déjà-vu. Elle encourage toujours à refuser les expressions toutes faites, les personnages conventionnels et n’hésite pas à se moquer des livres qui y ont recours. Je crains qu’Henry Mellish ne soit trop proche du classique Héros de Romans : un jeune homme séduisant, aimable et irréprochable (comme il en existe si peu dans la vraie vie). [p. 34.] De la même façon, elle applaudit les efforts pour donner de la profondeur, refuse le manichéisme. Pour Jane Austen, un personnage un peu ambigu est « bien plus intéressant ainsi que s’il avait été totalement bon ou affreusement mauvais ». J’imagine que vous êtes d’accord sur le principe, mais il est bon de le rappeler. Nous savons tous qu’il peut être difficile de doter ces personnages que nous chérissons tellement de failles ou de (vrais) défauts. De la logique et de la vraisemblance, les piliers d’écriture de Jane Austen. Pour Jane Austen, il faut être crédible aux yeux du lecteur. Inutile, dit-elle à l’une de ses nièces, d’accompagner tes personnages en Irlande, puisque tu n’y as jamais été. Qu’ils fassent leur voyage, mais pas de descriptions que des lecteurs pourraient juger fausses. De la même façon, les personnages doivent agir en fonction d’une seule et même personnalité, tout au long du roman. « Souviens-toi, elle est très prudente ; te ne peux la laisser agir de façon inconséquente ». Enfin, elle rappelle la nécessité de la vraisemblance. A ce niveau, elle fait une remarque que tout écrivain devrait garder en tête : ce n’est pas parce que quelque chose est vraiment arrivé, que ce sera acceptable dans un roman. J’ai supprimé le passage où Sir Thomas conduit en personne les autres hommes à l’étable le jour même où il s’est cassé le bras. Car, bien que ton Papa ait pu sortir se promener tout de suite après avoir soigné sa fracture du bras, c’est tellement inhabituel que cela ne me paraît pas naturel dans un livre.[ p. 23] Oublier son égo d’auteur et supprimer tout ce qui ne sert à rien. Tout auteur s’est trouvé un jour devant ce dilemme : un passage que l’on aime mais qui ne sert à rien. Jane Austen nous rappelle toute l’importance de savoir supprimer, tout en reconnaissant que cela peut nécessiter un peu de temps. J’espère qu’une fois que tu auras bien avancé, tu te sentiras capable de supprimer certaines des scènes précédentes. Celle avec Mrs Mellish doit être éliminée : elle est insipide et n’apporte rien à l’intrigue. [ p. 32] De la même façon, elle invite à être concise et à ne pas confondre plaisir d’écriture et plaisir pour la lecture : Tu dépeins un lieu fort agréable ; cependant tes descriptions sont souvent trop minutieuses pour rester attrayantes. Tu te disperses et donne trop de détails de-ci de-là. [ p. 29] Et oui, encore un auteur qui nous dit qu’écrire c’est aussi effacer… Pour le plaisir, une dernière citation : Pour terminer en beauté, voici l’un de mes passages préférés où l’on retrouve le ton caustique et la liberté d’idées de Jane Austen. Elle écrit à sa nièce Anna à propos d’un de ces personnages: Je préférerais que tu ne le fasses pas plonger dans un « Tourbillon de Débauche ». Je n’ai aucune objection pour la chose en elle-même mais je ne puis souffrir cette expression ; c’est une image littéraire tellement rebattue et si ancienne que j’ose affirmer qu’Adam la rencontra lorsqu’il ouvrit le premier roman ». [p. 36] N’hésitez pas à vous découvrir le livre, s’il ne parle pas entièrement d’écriture (seule la première partie en traite vraiment), il vous permettra de voir la distance entre l’auteur et ses personnages. Et ça, c’est aussi un élément à rechercher pour tout écrivain qui souhaite toucher ses lecteurs. Bonne lecture /écriture et à bientôt. Jane Austen, Du fond de mon cœur, lettres à ses nièces, Ed. Finitude, le livre de Poche, 2015, 185 p.
Ecrire avec Jane Austen : Du fond de mon cœur, lettres à ses nièces. Lire la suite »