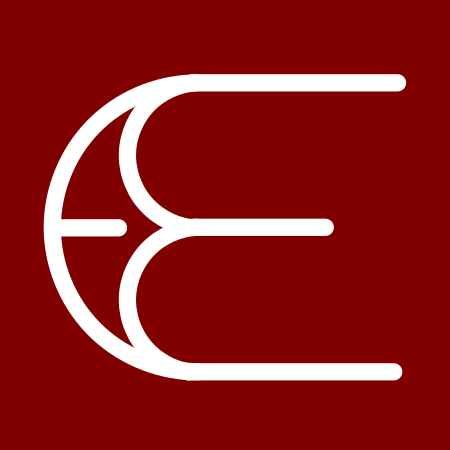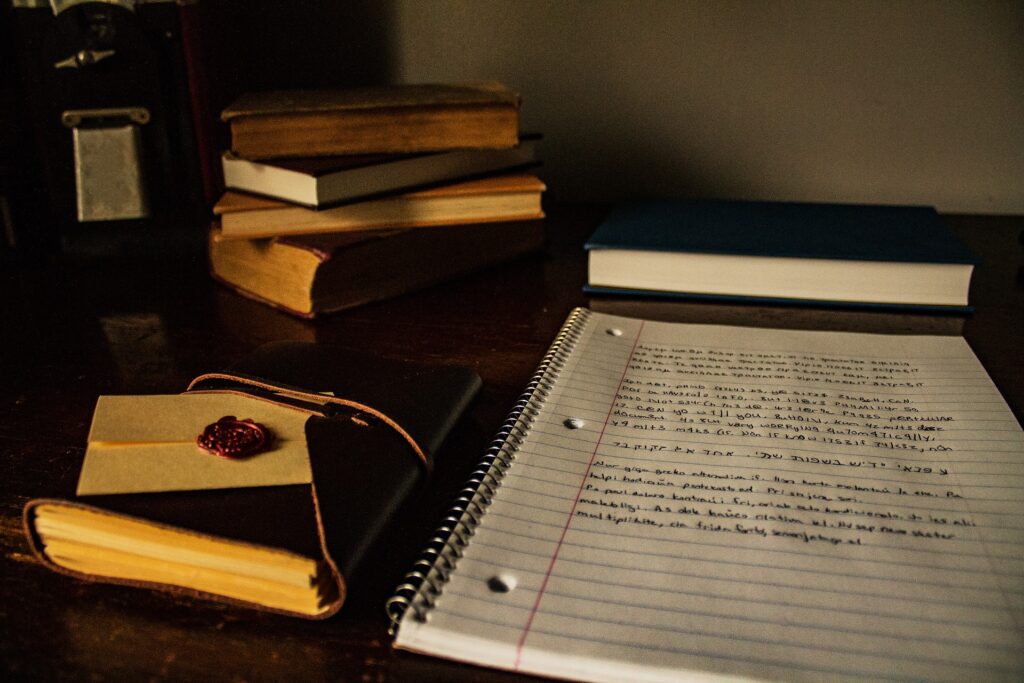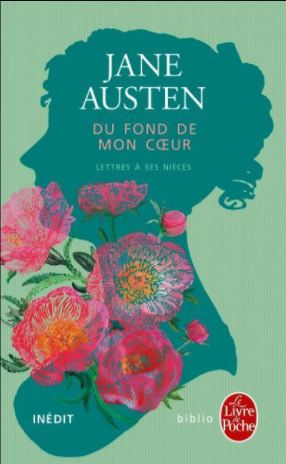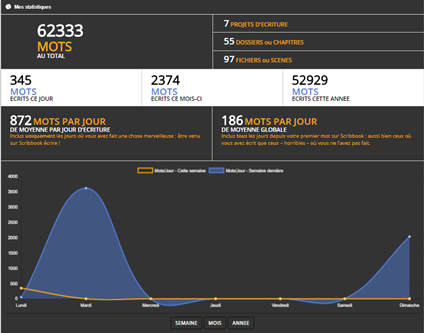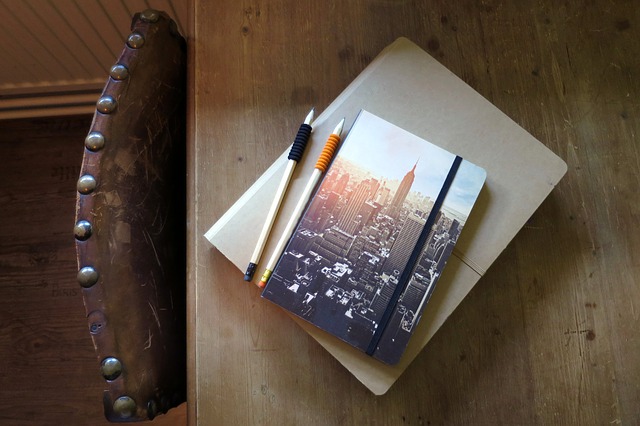Choisir son narrateur, comprendre la narration 1/4 : repères et définitions.
J’entends souvent des questions sur le narrateur. Le plus souvent, c’est « c’est mieux d’écrire en première ou en troisième personne ? ». Il n’y a qu’une bonne réponse : cela dépend du texte. Mais pour savoir quoi décider, il importe de comprendre ce qu’apportent les choix de la narration. Aussi je vous propose aujourd’hui un point sur quelques repères indispensables. Ensuite, dans les semaines qui viendront, j’approfondirai le concept de narrateur puis de focalisateur. Enfin, je terminerai par un balayage des modes et expérimentations actuelles en matière de narration. Ainsi, nous serons tous armés pour un nouvel appel à textes sur le thème du narrateur ! Quelques repères indispensables de la narration : auteur, narrateur, personnage, focalisateur La base de la base en matière de narration ! Il y a deux choses indispensables à retenir et je demande pardon d’avance à tous ceux pour qui c’est évident. En premier lieu: l’auteur et le narrateur d’un texte romanesque sont TOUJOURS deux instances différentes. Ensuite, il y a TOUJOURS dans tout texte romanesque un narrateur, même si on ne le « voit » pas à la lecture (s’il s’agit d’un narrateur externe). Comparez, par exemple les textes d’un auteur qui écrit pour les adultes et pour les enfants. Dans chacune de ces catégories de livres, il usera d’une voix différente : son narrateur sera différent. Auteur et narrateur L’auteur : un être physique Donc, l’auteur n’est pas le narrateur et inversement, et cela même si ces dernières années ont vu pleuvoir les livres jouant sur l’ambigüité, le faire-vrai et, il faut le dire, une certaine tendance au nombrilisme. En résumé, l’auteur c’est l’être physique qui a écrit le roman, qui l’a envoyé à une maison d’édition et dont vous pouvez trouver la photo. Le narrateur, une voix de papier: Le narrateur c’est celui qui, à l’intérieur du texte, raconte. C’est une voix, un être de papier qui peut se rapprocher de l’auteur mais n’est jamais complètement lui. Par exemple, on ne peut pas confondre Nabokov avec le narrateur de Lolita, le pathétique Humbert Humbert. Dans ce cas, c’est facile de les différencier. Dès les premières pages, l’auteur donne quelques indications biographiques qui, malgré l’utilisation du « je », permettent au lecteur curieux de tout de suite comprendre qu’il s’agit de deux entités différentes. Et pourtant, Nabokov a eu bien des problèmes avec des lecteurs qui l’assimilaient à son narrateur ! Parfois c’est plus compliqué. Ainsi de nombreux auteurs contemporains (Delphine de Vigan, Laurent Binet…) s’amusent à brouiller les limites, à proposer des narrateurs qui ont les mêmes données biographiques qu’eux, même si… Même si, lorsqu’on est dans du roman, cela reste du roman et donc une mise en fiction, qui transforme la réalité. C’est pourquoi, on ne peut pas confondre un roman avec un essai historique ou un article d’investigation (même s’il est arrivé que des romans servent de preuves dans des histoires criminelles ! ) Narrateur et focalisateur : Si le narrateur est celui qui raconte, le focalisateur est celui qui voit. Quelle différence me direz-vous et pour quoi faire ? Et bien, selon les cas, la différence peut être énorme. Bien sûr, c’est moins vrai dans le cas d’un récit à la première personne, où celui qui raconte est aussi celui qui regarde. Mais dans un récit à la troisième personne, les possibilités de combinaison sont multiples. Ainsi, dans un récit à la troisième personne, le narrateur peut « voir » à travers différents personnages. Il peut être engagé, neutre, absent ou omniprésent. Avec un exemple, c’est plus clair ! Comme la théorie n’est pas toujours très claire, prenons l’exemple de Ce que savait Maisie d’Henry James. Le roman raconte le divorce d’un riche couple à la fin du XIX à travers le regard de leur fille, Maisie. Maisie n’est pas la narratrice puisqu’elle est présentée à la troisième personne. Pourtant, tout ce qui apparaît dans le texte est connu à travers son seul regard. Le narrateur ne dit que ce qu’elle sait, avec sa perception d’enfant qui ne comprend pas tout. Dans ce cas, il y a donc un narrateur externe en troisième personne plus un focalisateur : le regard d’enfant. Bien sûr, ce mélange donne au texte une force extraordinaire. C’est lui qui permet de souligner la violence des parents et l’abandon de l’enfant, perdue dans le monde des adultes. Mais, si Maman n’était pas jeune, elle était donc vieille, et cette lumière nouvelle éclairait bizarrement le mariage de Maman avec un homme jeune.[…]Ces découvertes déconcertantes ajoutaient à la confusion d’idées chez l’enfant ; aucun de ces gens, semblait-il n’avait l’âge qu’il aurait dû avoir. C’était surtout vrai de Maman, et elle se réjouit davantage de n’avoir pas discuté avec Mrs Wix le degré d’affection que Sir Claude portait à sa femme. En conclusion ! Voyez-vous maintenant les différences et ce que leurs connaissances peuvent vous apporter ? Grace aux narrateurs et focalisateurs, vous pouvez jouer sur les indications que vous donnez au lecteur. Vous pouvez aussi lui faire prendre une part plus ou moins importante dans la construction de l’histoire. Dans un prochain article je vous détaillerai les possibilités qui existent pour le narrateur. En attendant, n’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions. [wysija_form id=”1″]
Choisir son narrateur, comprendre la narration 1/4 : repères et définitions. Lire la suite »